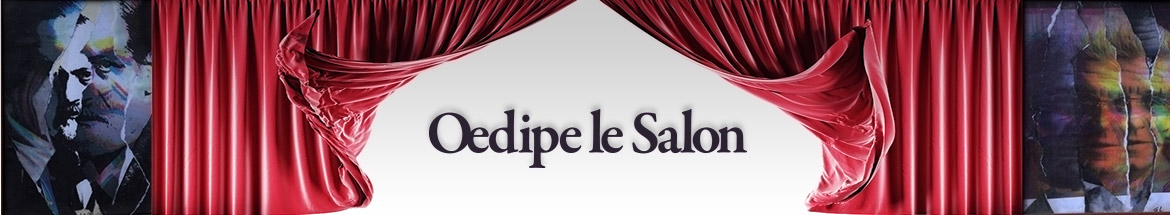Œdipe le Salon et Serge Sabinus sont heureux de vous faire part de la parution du dernier ouvrage de sa collection Œdipe Nomade : Œdipe à Leicester (GB)
Autour de « Richard III » de William Shakespeare – Le tragique en acte.
Commander aux éditions des crépuscules.
Par courrier (+ chèque de 20€), à Œdipe le Salon
chez Délia Kohen, 40 bis rue Violet, 75015 Paris.

C’est à Leicester, au nord de Londres, qu’Œdipe Nomade, poursuivant sa conversation psychanalytique avec les auteurs qui l’inspirent, a fait halte en septembre 2023 pour échanger sur le thème du « passage à l’acte » dans « La Tragédie de Richard III » de William Shakespeare. Là en effet, ce roi maudit, dernier de la dynastie des Plantagenêt, a été enterré, sans même une sépulture en 1485, après la bataille de Bosworth.
Ce qui a été mis au travail, ensemble à Leicester, c’est l’ampleur de la fascination que le mal exerce sur l’homme. Tyrannie et mépris du bien commun mis au service d’un seul font ménage avec la séduction par le langage à la mesure exacte d’un corps absolument fautif, brisé, laid et disharmonieux, que même le regard maternel désavoue. Corps de l’homme, corps de la femme, les noms et les titres affluent et se confondent, violence des mots et des actes. Là, nous avons posé l’analyste à l’épreuve de ce qui ne cesse pas de se passer, en un terme qui conjoint l’analyse et le théâtre, l’acte.
Tout est affaire de langage, nous enseigne Shakespeare. Au-delà des actes de pouvoir et de cruauté, le langage de Richard est celui du rêve-cauchemar qui envahit le corps brisé avant la grande dernière bataille. Déploiement du vide, qui ne le tient plus sur le devant du vivant, il n’est pas vraiment mort, pas vraiment vif, c’est l’entre-deux. Dans cet espace les fantômes sont des vifs : « Qu’ai-je à craindre ? Moi-même ? Il n’est nul autre ici. Richard aime Richard. Il n’est nul autre ici ». Dans ce « il n’est nul autre ici », se module la question du passage à l’acte. Si un sujet se construit avec un Autre inconscient, qu’en est-il de Richard, ce « sujet » abusé, sans autre possible, désespéré, noué par ses actes entre un passage à l’acte et un passage PAR l’acte ?

Programme
22 et 23 septembre 2023
En 2012, dans un parking municipal anglais à Leicester, au nord de Londres. des fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour les ossements bien conservés d’un homme jeune, avec une importante scoliose. Les analyses confirment qu’il s’agit de Richard III, dernier de la dynastie des Plantagenêt, mort en 1485 sur le champ de bataille de Bosworth près de Leicester, roi pendant à peine plus d’un an et demi. Cette bataille mit fin à la guerre des 2 Roses, qui, durant plusieurs générations, opposa la famille des York (à la Rose blanche), à celle des Lancastre (à la Rose rouge).
A 32 ans, meurt ainsi, seul sur le champ de bataille, le roi d’Angleterre à la pire réputation. Méchant autant que laid, cruel, impitoyable et machiavélique, il se débarrasse d’abord de ses frères, épouse sa belle-sœur après avoir assassiné son mari et son père, puis, laisse-t-on entendre, a participé aux meurtres de ses neveux âgés respectivement de 9 et 12 ans, emprisonnés par ses soins à la Tour de Londres, alors que l’aîné allait être couronné roi.
William Shakespeare, décrivant Richard III comme un roi sanguinaire et bossu dont l’arrivisme terrifiant s’infiltrait d’une solitude cauchemardesque, a fait de cette histoire une pièce géniale, la plus représentée de toutes.
En mars 2015, le cadavre de Richard III fut définitivement identifié. Il fut alors inhumé dans une pompe royale à la cathédrale de Leicester où il repose désormais.
C’est à Leicester même que nous vous proposons de travailler autour de ce personnage, tel que Shakespeare le met en scène dans ses pièces historiques, les trois « Henri VI » et « la tragédie de Richard III, the tragedy of Richard the Third ».
La tragédie de Richard s’écrit entre la passion de l’acte et l’infinie solitude, et c’est à cette question de l’acte, conjointe au théâtre et à l’analyse, que nous tenterons de nous éclairer.
Direction du colloque : Serge Sabinus
Intervenants(liste provisoire) : Annick Bianchini-Depeint, Isabelle Bonvalot, Fulvia Castellano, Jean-Jacques Chapoutot, Catherine Compagnone, Elisabeth Gontier, Françoise Hermon, Delia Kohen, Lysiane Lamantowicz, Jean-Jacques Leconte, Xavier Moya Plana, Monique Poncet, Joséphine Roques, Denise Sauget, Serge Sabinus.
INTRODUCTION AU COLLOQUE
Les psychanalystes ont déjà beaucoup appris bien sûr de Shakespeare : Macbeth, Hamlet, Othello, voire le Roi Lear ; mais ce qui m’a beaucoup intéressé ici est le rapport à la violence et la culpabilité qui s’y conjoint dans l’acte volontaire comme un appel de l’acting-out en rapport avec une perception du corps désorganisé, brisé. Richard, au cours de puissantes tirades (dans le dernier « Henri VI » et dans « Richard III ») met en avant son corps déformé : « Moi, mon corps n’est pas fait pour ces galants services » répète-il par trois fois dans l’immense et magnifique introduction de la Tragédie. « Je suis déterminé d’être un vrai scélérat » avoue-t-il dès les premiers vers. C’est ce long cri de rage, seul, qui ouvre la pièce. Mais il y a au cœur de la scélératesse son envers identique, tout aussi violent : « Je me hais moi-même pour ces actes hideux que moi-même j’ai commis… » finit-il par concéder.
C’est la mise au travail de l’acting-out. J’interroge en particulier de nouveau l’ignorance en termes psychanalytiques. N’est-elle pas ici ce qui secrètement, dans un« non-dit », agi dans le bruit et la fureur du pouvoir pour mener son auteur aux meurtres et à son quasi suicide, abandonné par les siens, seul, entouré de ses ennemis sur le champ de bataille de Bosworth: « un cheval, mon royaume pour un cheval »… Le passage à l’acte meurtrier se prolonge ainsi en passage à l’acte suicidaire.
Un autre point d’appel est remarquable dans la pièce : c’est la densité des femmes au travers de leur désarroi et leur violence verbale. Voyez-les toutes. D’abord Anne Neville, l’épouse de Richard, qui sera couronnée reine et mourra d’épuisement ; elle est la belle-fille de Marguerite d’Anjou, la « vieille reine », épouse de Henri VI le fou, mort comme leur fils Edouard de Lancastre à la bataille de Tewkesbury, qui ouvre la pièce. Élisabeth Woodeville ensuite, veuve du frère de Richard, le Roi Edouard IV qui se prépare à mourir au début de la tragédie. Sa succession, dans le calme relatif d’entre les guerres, est l’occasion des violences acharnées et machiavéliques de Richard. Enfin, il y a la Duchesse d’York, Cécile Neville, la mère du tyran et de ses 3 frères, le Roi Edouard IV, Edmond de Rutland, Georges de Clarence, et ses 3 sœurs, Anne, Élisabeth et Marguerite.
Trois Reines donc et Cécile Neville dont on suivra pour ces quatre femmes les violences verbales, outrées et désespérées. Quelle est leur place vive au cours du règne de Richard III ? Quel est le fil qu’elles déroulent dans la confusion des noms dans ce monde où l’acte devance les mots… « Il faut me supporter – s’écrie Marguerite alors que la guerre ultime est toute proche – Affamée de vengeance, je me repais ici… » et plus loin, s’adressant en hurlant à Richard, semant le trouble : « Il est mort ton Edouard, qui tua mon Edouard ; ton autre Edouard est mort pour prix de mon Edouard ». La confusion règne dans ces tournoiements de mot et s’apprête à prendre le pas sur l’action.
Les femmes, épouses et mères, sont en deuil… enfants, époux, assassinés par un seul, Richard III, rusant sans âme vers le pouvoir. « La terre s’ouvre, l’enfer flambe, les démons rugissent, les saints prient… que, vivante, je dise enfin : « le chien est mort » ». Les femmes, « toutes » au sens psychanalytique peut-être, d’un seul cri appellent à la mort de Richard III. Dire enfin : « le chien est mort».
Pour le lecteur, comme pour le spectateur, les noms tournent et retournent mêlant à leur confusion les cris de haine et de désespoir : « despair and die » crient à Richard dans son dernier cauchemar les morts qui, l’un après l’autre, viennent le hanter à l’aube de la bataille de Bosworth.
L’histoire, portée par le Chroniqueur de Crowland et le poète de la Ballade of Bosworthfield, nous apprend qu’en effet « le chien est mort ». Son corps ravagé fut aussitôt conduit « aussi nu que le jour de sa naissance, par Henri VII et sa troupe Tudor, chez les Franciscains sans cérémonie ni épitaphe. » Et c’est là que nous le retrouvons, à Leicester, quelques cinq siècles plus tard.
Ce qui pourrait être mis au travail ensemble c’est, de manière essentielle ici, l’ampleur de la fascination que le mal exerce sur l’homme. Règne une « esthétique du sinistre » au vif de la nature du pouvoir et de ses perversions. Tyrannie et mépris du bien commun mis au service d’un seul font ménage avec un pouvoir de séduction par le langage à la mesure exacte d’un corps décrit comme absolument fautif, brisé, laid et disharmonieux. Corps de l’homme, corps de la femme, les noms et les titres affluent et se confondent, violence des mots et des actes. Ici, posons ensemble l’analyste à l’épreuve de ce qui ne cesse pas de se passer, en un terme qui conjoint l’analyse et le théâtre, l’acte. Passage à l’acte – acte sans parole, il n’a pas de sens, acting-out – acte repris dans une mise en mots… Y aurait-il ici une autre forme « d’acte »?
Tout est affaire de langage et c’est bien ce que nous enseigne le théâtre de Shakespeare. Seul, sans image, alors que son monde danse dans ces temps du repos, des fêtes et de l’amour, au temps des « sportive tricks », Richard n’a que du langage à opposer à ses difformités dans le miroir. Et ce langage est celui du rêve-cauchemar qui envahit le corps brisé avant la grande dernière bataille. C’est le déploiement du vide, immense qui ne le tient plus sur le devant du vivant, il n’est pas vraiment mort, pas vraiment vif, c’est l’entre-deux. Et dans cet espace les fantômes sont des vifs : «Qu’ai-je à craindre ? Moi-même ? Il n’est nul autre ici. Richard aime Richard. Il n’est nul autre ici ».
C’est à explorer ce qui vient là, « il n’est nul autre ici », à l’entendre dans son vif, que se module la question du passage à l’acte. Si un sujet se construit avec un Autre inconscient, qu’en est-il de Richard, ce « sujet » abusé, sans Autre possible, désespéré, noué par ses actes entre un passage à l’acte et un passage PAR l’acte ?
Serge Sabinus
Quelques références :
1 « Shakespeare » par Claude Mourthé,chez Folio/Biographies, 2006.
2 « William Shakespeare. Œuvres complètes -Histoires II », Édition bilingue, dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, 1997 (on y trouve les 3 Henri VI, Richard III, Sir Thomas More et Henri VIII).
3 « Richard III » par Aude Mairey chez Ellipses, collection Biographies et mythes historiques, 2011.
4. « RICHARD III, Le roi maudit ? » par Georges Minois, chez Perrin, collection Biographies, 2022.
4 Éventuellement, la version de Richard III chez Gallimard, collection Le Manteau d’Arlequin, 1995,pour la magnifique traduction de Jean Michel Déprats (également parue chez Folio Théâtre, 2021, avec unintéressant témoignage de Georges Lavaudant).
5. Enfin, indispensable, la magnifique version filmée intitulée « Looking for Richard » de Al Pacino disponible en DVD.